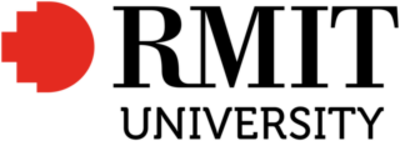À la croisée de l’expérience esthétique et de l’engagement citoyen, les œuvres participatives, pour lesquelles des artistes professionnels et des personnes « non-artistes » créent ensemble au cœur des territoires, bousculent les codes. Porteuses d’ambitions fortes, reliant l’art et la vie quotidienne, ces démarches sont pourtant toujours en quête de reconnaissance, tant de la part des institutions que des mondes de l’art.
Il arrive que des personnes non professionnelles de l’art soient invitées à prendre part à la conception et/ou à la réalisation d’œuvres. Cet art dit participatif couvre un large éventail de pratiques. Nous avons par exemple étudié des projets d’art citoyen portant sur des expérimentations inscrites dans un temps long (deux à quatre ans), investissant des lieux a priori non dédiés à l’art, générant – au fil de processus ouverts et évolutifs – des réalisations singulières qui bousculent la notion d’œuvre : un Fol Inventaire de toutes les plantes de la Terre, la carte sensible d’un quartier populaire, des impromptus de poésie à 2 mi-mots, un café-œuvre ou encore une immense robe avec soixante poches garnies d’objets insolites…
La notion d’œuvre artistique en question
L’artiste Pablo Helguera distingue les créations prétendument participatives se bornant en réalité à un apport limité, dans le cadre d’un projet prédéterminé, et celles où les personnes associées dès la genèse d’une œuvre sont susceptibles de la (re)modeler. Dans cette lignée, deux concepts ont été récemment élaborés : celui d’art en commun par l’historienne de l’art Estelle Zhong Mengual et celui de co-création par l’artiste chercheuse Marie Preston. Désacralisant la posture d’auteur (l’auctorialité), ces notions invitent à reconnaître le potentiel créatif de chaque personne et même à envisager qu’une œuvre puisse être cosignée par les différentes parties prenantes. Cette approche peut donner lieu, dans certains cas, assez rares, à une répartition des éventuels bénéfices financiers, au-delà de la seule rétribution symbolique (reconnaissance, sentiment de fierté, etc.).
Très souvent, les initiateurs d’actions participatives insistent sur la primauté du mode de faire sur le « résultat » final, ce qui tend à laisser dans l’ombre l’étendue et la valeur artistique des formes créées, lesquelles sont tantôt tangibles ou immatérielles, uniques ou reproductibles, pérennes ou éphémères, spectaculaires ou furtives. Par ailleurs, la documentation recueillie au fil du processus (un blog, une édition, un film, etc.) constitue parfois, outre sa fonction d’archive, un objet-trace doté d’un statut d’œuvre à part entière.
Ces réflexions concernent les pratiques artistiques contemporaines dans leur ensemble (participatives ou non) où, en réaction aux logiques productivistes, la notion d’œuvre, sa matérialité sont interrogées, et même son bien-fondé, certains artistes revendiquant sa disparition. Le critique d’art Stephen Wright évoque même « un art sans œuvre, sans auteur et sans spectateur ».
Tisser ambition artistique et droits culturels

Nées d’une immersion à l’occasion de temps de résidence, certaines propositions participatives découlent d’un travail dit situé qui fait possiblement de l’artiste un « passeur de territoire ». S’affranchissant des logiques classiques de diffusion, elles s’inscrivent davantage dans une démarche d’infusion. Pour « tenter de réduire, à défaut de pouvoir les abolir, les distances métriques, mais aussi culturelles, linguistiques et cognitives », les artistes déploient différents moyens : marches sensibles ; déplacements en triporteur ou avec un âne ; bureau mobile installé sur la place du marché ; moments de convivialité autour d’un banquet…
Au-delà du seul déplacement physique, l’enjeu est de renouveler les liens entre art et société. Remontant aux années 1970, identifiées dans un rapport emblématique paru en 2001 : Les Nouveaux territoires de l’art du sociologue Fabrice Lextrait, de telles initiatives font écho aux concepts d’esthétique relationnelle et de créations en contexte forgés respectivement par les historiens de l’art Nicolas Bourriaud et Paul Ardenne. Un certain nombre d'entres-elles se sont fédérées au sein de l’association Autre(s) pARTs. Fondées idéalement sur la réciprocité et l’horizontalité, ces démarches participatives résonnent également avec les théories de « l’aller-vers » du champ social.
Outre le fait qu’elles associent souvent plusieurs disciplines artistiques (arts visuels, spectacle vivant…), ces propositions composent également avec d’autres pratiques (cuisine, jardinage, bricolage…) et d’autres champs (travail social, santé, écologie…) que celui de l’art. Élargissant ainsi sa définition même, elles rejoignent les analyses de l’historien de l’art Maurice Fréchuret autour du rapprochement entre l’art et la vie et incarnent la notion d’art comme expérience élaborée par le philosophe John Dewey. Brouillant les frontières, elles donnent naissance à des formes hybrides, parfois déroutantes.
Comme le note le sociologue Pascal Nicolas-Le Strat :
« L’art apparaît désormais comme une pratique diffuse, articulée aux autres activités sociales, en prise avec de nombreuses dimensions de l’existence. »
Signes des tensions persistantes entre exigence artistique et dimension sociale, dans leur immense majorité, les financements (publics ou privés) des pratiques participatives relèvent davantage d’enveloppes consacrées à l’action culturelle et non à la création. Généralement centrées sur des critères quantitatifs, les subventions peuvent générer des situations d’instrumentalisation des démarches de création et/ou des personnes sollicitées ou encore des risques d’injonction à la participation, comme le pointe le sociologue Loïc Blondiaux.
En l’absence de dispositifs adaptés, les créations partagées émergent grâce à l’inventivité le plus souvent d’associations, mais également des quelques institutions qui leur accordent de la considération. Plutôt que de les corseter par des modes de soutien trop contraignants, il s’agirait d’accepter la part d’indétermination inhérente à ces projets en leur accordant « une avance de confiance », et en corollaire, comme pour toute autre création artistique, un droit à l’erreur.
Vers une reconnaissance des mondes de l’art et des politiques publiques ?
La visibilité des œuvres participatives, censées être « vécues de l’intérieur », devrait-elle rester cantonnée, comme c’est souvent le cas, aux contextes singuliers dont elles sont issues ? Pourquoi ne pourraient-elles pas, sous réserve de l’accord des principaux intéressés, rencontrer une plus large audience ? En effet, au-delà des enjeux d’émancipation et de « vivre ensemble » classiquement invoqués, les créations partagées avec une réelle diversité de personnes recèlent un potentiel pour déranger les écritures contemporaines et contribuer ainsi au renouvellement des formes et pratiques artistiques. Face aux limites de la démocratisation culturelle, elles représentent une piste pour faire vivre une véritable démocratie culturelle.
À Sevran (Seine-Saint-Denis), depuis 2018, le Théâtre de la Poudrerie, scène conventionnée « art et territoire » les met en lumière à travers sa Biennale de la création participative. La toute récente Fédération des arts participatifs invite à les considérer « comme une composante essentielle et légitime de la création contemporaine ». Pour sa part, le chercheur Philippe Henry appelle à un soutien public renforcé à des initiatives en mesure de « construire une démocratie artistique et culturelle vraiment digne de ce nom ». Cette reconnaissance garantirait à ces projets complexes de meilleures conditions matérielles et humaines de réalisation, tout en actant une interdépendance entre éthique et esthétique.

Cet article est publié dans le cadre de la série « Regards croisés : culture, recherche et société », publiée avec le soutien de la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la culture.